« Oh, there's weirdo perversions galore !
Guns, hookers and drugs by the score;
Critics should pan it,
They really should ban it,
Or at least put it front of the store »
 Après les psychédélicieux Vurt et Pollen, les éditions la Volte publient aujourd’hui, avec deux nouvelles couvertures signées Corinne Billon, deux autres livres du punk de Manchester, Jeff Noon : un roman, NymphoRmation, et un recueil de
Après les psychédélicieux Vurt et Pollen, les éditions la Volte publient aujourd’hui, avec deux nouvelles couvertures signées Corinne Billon, deux autres livres du punk de Manchester, Jeff Noon : un roman, NymphoRmation, et un recueil de nouvelles, d’histoires, bon, enfin, de fragments, dubs et remix en tout genre : Pixel Juice – respectivement traduits par Alfred Boudry et Marie Surgers. Je remets donc Jeff Noon en première page, avec d’abord un retour sur Pollen (critique parue dans Galaxies n°40 en 2006), puis avec NymphoRmation et Pixel Juice. Si vous ne vous êtes toujours pas plongés dans l’univers désaxé de ce fou-furieux, va falloir vous bouger le cul.
En 1997, les éditions Flammarion publiaient dans leur collection de littérature étrangère un premier roman remarquable, Vurt (1993), alors auréolé d’un prix Arthur C. Clarke. Jeff Noon avait imaginé un monde futuriste totalement déjanté dans lequel le continuum des rêves et des espaces intérieurs interférait (de manière limitée) avec le Réel. Prégnant, original, Vurt était pourtant passé relativement inaperçu ; Alice automate, publié en France l’année suivante, encore plus.
 Pollen (1996) est le deuxième roman situé dans l’univers du Vurt – ou plutôt, dans l’un des univers du Vurt, puisque d’un livre à l’autre, celui-ci recouvre des réalités différentes. Cette fois, Noon délaisse ses héros junkies accros aux plumes codées pour nous conter les hauts-faits d’un combat titanesque opposant le Vurt au monde réel. Au passage, nous apprenons qu’une drogue aphrodisiaque vurtuelle désormais interdite, « Fécondité 10 », avait jadis rompu les barrières génétiques qui interdisaient les accouplements entre espèces différentes. Résultat de cette gigantesque orgie : Manchester, où les « Purs » se font rares, est peuplée d’êtres hybrides de toutes sortes, comme des hommes-chiens ou ces zombies des Limbes, rejetons monstrueux d’unions nécrophiles…
Pollen (1996) est le deuxième roman situé dans l’univers du Vurt – ou plutôt, dans l’un des univers du Vurt, puisque d’un livre à l’autre, celui-ci recouvre des réalités différentes. Cette fois, Noon délaisse ses héros junkies accros aux plumes codées pour nous conter les hauts-faits d’un combat titanesque opposant le Vurt au monde réel. Au passage, nous apprenons qu’une drogue aphrodisiaque vurtuelle désormais interdite, « Fécondité 10 », avait jadis rompu les barrières génétiques qui interdisaient les accouplements entre espèces différentes. Résultat de cette gigantesque orgie : Manchester, où les « Purs » se font rares, est peuplée d’êtres hybrides de toutes sortes, comme des hommes-chiens ou ces zombies des Limbes, rejetons monstrueux d’unions nécrophiles…
Taxi-chien à la cool, Coyote est tué par une jeune fille mystérieuse répondant au nom de Perséphone, d’une façon plus qu’étrange – d’un baiser, la tueuse a introduit dans la gorge de sa victime une fleur létale dont les racines s’implantent dans les poumons – alors qu’il la convoyait à Manchester. Tandis que Sibyl l’Ombre-flic (qui peut capter les dernières pensées d’un mort) et Zéro le chien flic enquêtent sur ce meurtre – sous le regard désapprobateur du chef de la police, Kracker –, Boda, malheureuse conductrice d’Xcab, fuit les sbires de Colombus chargés de l’éliminer. Heureusement, le DJ hippy Gombo Yaya, défoncé 24h/24, entreprend d’aider Boda au nez et à la barbe d’une police un peu dépassée par les événements – d’autant que, pour couronner le tout, le taux de pollen dans l’atmosphère mancunienne ne cesse d’augmenter… Peu à peu la fièvre gagne les habitants, les éternuements se multiplient, la morve coule à flot. Seuls les « Dodos » (celles et ceux qui ne peuvent rêver et n’ont donc pas accès au Vurt), semblent immunisés : ce pollen empoisonné serait-il d’origine vurtuelle ?
L’enjeu de ces « futurs mystères de Manchester » (le Vurt de Pollen, contemporain de La balle du néant, est assez semblable à la Psychosphère de Roland C. Wagner) n’est rien de moins que la tentative d’invasion du Réel par l’une des plus puissantes créatures du Vurt, John Barleycorn, et son épouse Perséphone. Dans ce réservoir d’inconscient collectif qu’est le Vurt, Barleycorn est la représentation personnifiée du Mal ; il est Satan, il est Lucifer, il est Hadès.
On a souvent comparé Jeff Noon à William Gibson. Ce n’est pas immérité, mais nous dirions plutôt que Noon serait un Gibson sous acide, amateur – comme Ballard – de Dali plutôt que d’informatique, et qui aurait laissé libre cours à son imagination. Dans Pollen les standards du rock se succèdent, des Stones au premier album des Pink Floyd ; les éternuements s’étalent sur trois pages ; les hommes baisent tout ce qui bouge, y compris des plantes vertes… Bref, Jeff Noon invente le flowerpunk. Certes, le récit, qui commence comme un roman noir extravagant pour nous plonger ensuite dans un véritable tourbillon d’images surréalistes, menace plusieurs fois de se perdre dans les limbes du n’importe quoi. Mais Jeff Noon déploie un tel talent narratif, une telle maîtrise des dialogues, que jamais la frontière du ridicule n’est franchie.
Néanmoins, quand Vurt et sa bande de junkies pathétiques émouvaient, et évoquaient non sans génie les conséquences de la possible convergence, dans un avenir proche, des drogues et des réalités virtuelles, Pollen se veut davantage ludique – lire : davantage superficiel. Noon s’amuse visiblement comme un fou à inventer un univers littéraire avec ses lois et sa logique propres, qui s’impose moins, ici, comme une allégorie ou une réflexion sur le Mal, que comme un pur exercice de style, brillant mais un peu vain. Ça manque donc un peu de rationalité et de profondeur, c’est un peu gratuit sur les bords, mais c’est du concentré d’imaginaire, c’est délirant, c’est destroy, c’est poétique, c’est psychédélique et complètement barré : c’est Pollen.
*
NymphoRmation (Nymphomation en version originale) opère une synthèse réussie entre la langue explosive et ludique de Pollen, et l’équilibre romanesque – à peine moins fou mais plus attachant – de Vurt.
JOUEZ POUR GAGNER
1999. c’est l’heure de l’AnnoDomino à Manchester. Partout vrombissent les publimouches (les blurbflies, en VO), qui assènent leurs slogans.
« C’est l’heure du domino !
L’heure du domino !
L’heure du dom, dom, dom, dom, domino ! »
 Toute la ville vit au rythme du grand jeu AnnoDomino. Oubliez le Loto. Oubliez le derby City-United. Chaque semaine, la même frénésie. Les dominos sont la seule réalité. Domino=Maître=Dieu. Jazir Malick, étudiant, hacker et serveur dans le restaurant indien de son père, le Samosa doré ; Daisy Love, étudiante en théorie des jeux ; Tite Miss Celia et sa plume dans les cheveux, alias Celia Hobart ; Maximus Hackle, professeur d’université inventeur du « labyrinthe d’amour » et rédacteur en chef de Gombo de nombres ; et toute la clique de la Fractale Noire, avec Benny le Tendre, DJ Dopejack et Joe Crocus ; même ce faf de Nigel Zuze et ses potes rugbymen (« L’école anglais aux cons d’anglais ! »), même les Burgers (c’est comme ça qu’on appelle les flics, sponsorisés par la chaîne de fast-foods Whoomphy et son mythique « W »), même les mendiants publiexcités dans leurs trous officiels, tous ne jurent que par leurs jetons. JOUEZ POUR GAGNER ! Achetez vos osselets, matez la danse lascive de la belle Cookie Luck, et laissez la magie opérer : si vos dominos correspondent aux points qu’affiche la combinaison de miss fortune quand elle s’immobilise, alors vous devenez M. Million ! Mais gare au Bouffon-Double… « C’est l’heure du domino ! L’heure du domino ! L’heure du dom, dom, dom, dom, domino ! » Bien qu’ils soient sérieusement accros, Daisy Love, Jaz et leurs compères de la Fractale Noire vont essayer de percer les secrets du jeu, qu’ils jugent dangereux, et de remonter à sa source… Leur quête mathémagique va les propulser au cœur de la nymphoRmation (un protocole d’accouplement des nombres, ou la sexualité appliquée à l’information...). La chance au jeu a-t-elle une origine génétique ? Jaz va-t-il se métamorphoser en Jaz-publimouche ? Qui se cache derrière M. Million ? Comment faire un bon poulet Dhansak ?
Toute la ville vit au rythme du grand jeu AnnoDomino. Oubliez le Loto. Oubliez le derby City-United. Chaque semaine, la même frénésie. Les dominos sont la seule réalité. Domino=Maître=Dieu. Jazir Malick, étudiant, hacker et serveur dans le restaurant indien de son père, le Samosa doré ; Daisy Love, étudiante en théorie des jeux ; Tite Miss Celia et sa plume dans les cheveux, alias Celia Hobart ; Maximus Hackle, professeur d’université inventeur du « labyrinthe d’amour » et rédacteur en chef de Gombo de nombres ; et toute la clique de la Fractale Noire, avec Benny le Tendre, DJ Dopejack et Joe Crocus ; même ce faf de Nigel Zuze et ses potes rugbymen (« L’école anglais aux cons d’anglais ! »), même les Burgers (c’est comme ça qu’on appelle les flics, sponsorisés par la chaîne de fast-foods Whoomphy et son mythique « W »), même les mendiants publiexcités dans leurs trous officiels, tous ne jurent que par leurs jetons. JOUEZ POUR GAGNER ! Achetez vos osselets, matez la danse lascive de la belle Cookie Luck, et laissez la magie opérer : si vos dominos correspondent aux points qu’affiche la combinaison de miss fortune quand elle s’immobilise, alors vous devenez M. Million ! Mais gare au Bouffon-Double… « C’est l’heure du domino ! L’heure du domino ! L’heure du dom, dom, dom, dom, domino ! » Bien qu’ils soient sérieusement accros, Daisy Love, Jaz et leurs compères de la Fractale Noire vont essayer de percer les secrets du jeu, qu’ils jugent dangereux, et de remonter à sa source… Leur quête mathémagique va les propulser au cœur de la nymphoRmation (un protocole d’accouplement des nombres, ou la sexualité appliquée à l’information...). La chance au jeu a-t-elle une origine génétique ? Jaz va-t-il se métamorphoser en Jaz-publimouche ? Qui se cache derrière M. Million ? Comment faire un bon poulet Dhansak ?
Vous le saurez en lisant NymphoRmation, roman de la guerre des pubs et du jeu divisé en sept manches, souvent interrompu par les slogans des publimouches comme par les règles du jeu (règle 3a : Le jeu est sacro-saint), qui s’attaque pour notre plaisir aux paradis artificiels médiatiques. Jeff Noon cède parfois à quelques facilités (la fin, un peu trop grandguignolesque) mais reste un incroyable littérateur (chaque chapitre commence par un survol de la ville, où s’entrechoquent et fusionnent les mots ; la 45ème manche est ainsi introduite : « Petit matin gris du Jungement dernier. Azimutée. Nonchester la moisie. Lèche tes n’ombres. Manche 45, ô tochtones aux 0ssements éloquents. Faites des bourgeons à la fêlévision. Regardez tout miel le généfric digitastiqué. » etc.) et nous propose une nouvelle galerie de personnages savoureux, qui en dépit du caractère hautement chaotique des événements, parviennent à nous émouvoir. C’est que, si son inventivité éclate à chaque page, NymphoRmation bénéficie d’une construction solide, et d’un art certain de la narration empruntant certains codes et son suspense au polar. C’est aussi parce qu’il nous parle du réel. Les mots se mélangent comme les populations, comme les quartiers, comme les technologies. Peaux brunes, noires, blanches. Pauvres, riches, classes moyennes. Homos, bis, hétéros. Filles, garçons, mouches. Curry, coriandre et morceaux d’information. NymphoRmation, c’est ici, et c’est maintenant.
*
 Avec ses cinquante fragments, dubs et (tout de même) nouvelles, souvent liés entre eux (par un personnage, un thème ou un sample…), le kaléidoscopique Pixel Juice, grand mix d’imaginaire, nous fait lui aussi passer à travers le(s) miroir(s) labyrinthiques de notre société de l’information et du virtuel, où tout se confond, où tout peut arriver, et arriver de mille façons – surtout dans nos crânes et dans les réseaux informatiques. Et dans les livres de Noon. Dans le prologue et l’épilogue du recueil, l’auteur évoque un événement marquant (authentique ou pas) de son enfance, lorsqu’il avait sept ans : un camarade lui propose d’échanger sa superbe maquette d’Aston Martin contre une montre invisible. Le petit garçon accepte, bien sûr. Trop naïf aux yeux des autres, il semble pourtant avoir gagné au change : le pouvoir de l’imagination est illimité.
Avec ses cinquante fragments, dubs et (tout de même) nouvelles, souvent liés entre eux (par un personnage, un thème ou un sample…), le kaléidoscopique Pixel Juice, grand mix d’imaginaire, nous fait lui aussi passer à travers le(s) miroir(s) labyrinthiques de notre société de l’information et du virtuel, où tout se confond, où tout peut arriver, et arriver de mille façons – surtout dans nos crânes et dans les réseaux informatiques. Et dans les livres de Noon. Dans le prologue et l’épilogue du recueil, l’auteur évoque un événement marquant (authentique ou pas) de son enfance, lorsqu’il avait sept ans : un camarade lui propose d’échanger sa superbe maquette d’Aston Martin contre une montre invisible. Le petit garçon accepte, bien sûr. Trop naïf aux yeux des autres, il semble pourtant avoir gagné au change : le pouvoir de l’imagination est illimité.
La preuve, dans Pixel Juice, il est question : du légendaire dixième magasin, d’un boisson addictive aux six parfums d’ABSOLU, de paroles qui suicident, de la « Métaphorazine » (ou comment s’envoyer du langage dans les veines), d’allergies alphabétiques, de macs en pagaille, de publimouches, de scaraboussoles, d’une « Cabine Fetish », du projet Alice de Chromosoft et de sa technologie Mirrors, de pubs qui tuent (d’ailleurs la mort devient la pub ultime), de clones-miroirs, d’un mode d’emploi incomplet pour un appareil douteux dont on se saura rien, de la joie d’être pixélisé dans un reportage TV, du système antivol Stigmatica, de la castration numérique, d’une charismachine, d’une chasse à on ne sait trop quoi, du dangereux système Muse, d’une promo exceptionnelle, et même de quelques plumes. Entre autres.
Et ça fonctionne. Jeff Noon excelle dans la forme courte, voire très courte, dans la fulgurance comme dans la forme romanesque. Certains fragments (comme chez Ballard, dans Fièvre guerrière notamment) sont même constitués de lexiques, de modes d’emplois, d’annonces publicitaires. Mais, si l’on peut juger les « dubs » et autres « remix » poétiques un peu légers – du moins dans leur traduction française –, et si les nouvelles plus conventionnelles dans leur forme (« Mini Mac ») sont généralement moins excitantes, c’est dans sa cohérence d’ensemble que Pixel Juice, aux influences multiples (Borges, Gibson, Carroll, Ballard, Burroughs, Cronenberg, Lee Scratch Perry…) impressionne vraiment. A priori, rien de commun entre, par exemple, le récit de « Mini Mac », qui nous décrit l’ascension et la chute d’un mac d’une dizaine d’années, et la promo spéciale pour le modèle Hyper Alice, ou le Dogga dub du DJ Robochien J-Loop… Et si chaque texte en appelle un autre, c’est toujours de façon imprévisible. Tout s’emboîte, mais si l’on oublie le prologue/épilogue, il n’y a ni début, ni fin, comme un Rubik’s Cube qui n’aurait pas de solution, mais aux combinaisons infinies – comme autant de visions, entre dystopie et conte de fée, de notre monde.
Son esthétique singulière, cette manière bien à lui (métaphorisée par la nymphoRmation), de « mixer » les mots et les idées, de les laisser s’accoupler en toute liberté, sied parfaitement à ses récits-miroirs : dans la vie, comme sur le dance-floor ou en littérature, rien ne vaut un bon mix. Vivement la traduction de l’expérimental Cobralingus…
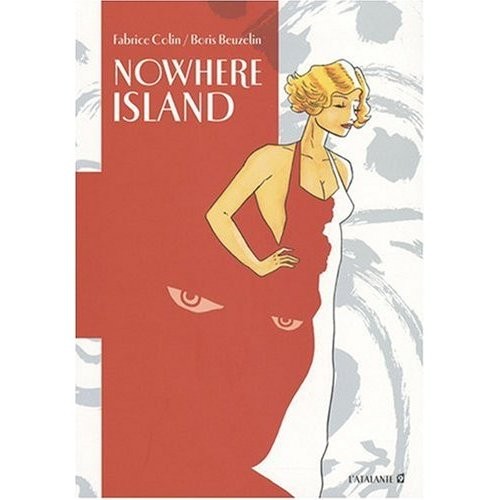


 Après les psychédélicieux
Après les psychédélicieux  Pollen (1996) est le deuxième roman situé dans l’univers du Vurt – ou plutôt, dans l’un des univers du Vurt, puisque d’un livre à l’autre, celui-ci recouvre des réalités différentes. Cette fois, Noon délaisse ses héros junkies accros aux plumes codées pour nous conter les hauts-faits d’un combat titanesque opposant le Vurt au monde réel. Au passage, nous apprenons qu’une drogue aphrodisiaque vurtuelle désormais interdite, « Fécondité 10 », avait jadis rompu les barrières génétiques qui interdisaient les accouplements entre espèces différentes. Résultat de cette gigantesque orgie : Manchester, où les « Purs » se font rares, est peuplée d’êtres hybrides de toutes sortes, comme des hommes-chiens ou ces zombies des Limbes, rejetons monstrueux d’unions nécrophiles…
Pollen (1996) est le deuxième roman situé dans l’univers du Vurt – ou plutôt, dans l’un des univers du Vurt, puisque d’un livre à l’autre, celui-ci recouvre des réalités différentes. Cette fois, Noon délaisse ses héros junkies accros aux plumes codées pour nous conter les hauts-faits d’un combat titanesque opposant le Vurt au monde réel. Au passage, nous apprenons qu’une drogue aphrodisiaque vurtuelle désormais interdite, « Fécondité 10 », avait jadis rompu les barrières génétiques qui interdisaient les accouplements entre espèces différentes. Résultat de cette gigantesque orgie : Manchester, où les « Purs » se font rares, est peuplée d’êtres hybrides de toutes sortes, comme des hommes-chiens ou ces zombies des Limbes, rejetons monstrueux d’unions nécrophiles… Toute la ville vit au rythme du grand jeu AnnoDomino. Oubliez le Loto. Oubliez le derby City-United. Chaque semaine, la même frénésie. Les dominos sont la seule réalité. Domino=Maître=Dieu. Jazir Malick, étudiant, hacker et serveur dans le restaurant indien de son père, le Samosa doré ; Daisy Love, étudiante en théorie des jeux ; Tite Miss Celia et sa plume dans les cheveux, alias Celia Hobart ; Maximus Hackle, professeur d’université inventeur du « labyrinthe d’amour » et rédacteur en chef de Gombo de nombres ; et toute la clique de la Fractale Noire, avec Benny le Tendre, DJ Dopejack et Joe Crocus ; même ce faf de Nigel Zuze et ses potes rugbymen (« L’école anglais aux cons d’anglais ! »), même les Burgers (c’est comme ça qu’on appelle les flics, sponsorisés par la chaîne de fast-foods Whoomphy et son mythique « W »), même les mendiants publiexcités dans leurs trous officiels, tous ne jurent que par leurs jetons. JOUEZ POUR GAGNER ! Achetez vos osselets, matez la danse lascive de la belle Cookie Luck, et laissez la magie opérer : si vos dominos correspondent aux points qu’affiche la combinaison de miss fortune quand elle s’immobilise, alors vous devenez M. Million ! Mais gare au Bouffon-Double…
Toute la ville vit au rythme du grand jeu AnnoDomino. Oubliez le Loto. Oubliez le derby City-United. Chaque semaine, la même frénésie. Les dominos sont la seule réalité. Domino=Maître=Dieu. Jazir Malick, étudiant, hacker et serveur dans le restaurant indien de son père, le Samosa doré ; Daisy Love, étudiante en théorie des jeux ; Tite Miss Celia et sa plume dans les cheveux, alias Celia Hobart ; Maximus Hackle, professeur d’université inventeur du « labyrinthe d’amour » et rédacteur en chef de Gombo de nombres ; et toute la clique de la Fractale Noire, avec Benny le Tendre, DJ Dopejack et Joe Crocus ; même ce faf de Nigel Zuze et ses potes rugbymen (« L’école anglais aux cons d’anglais ! »), même les Burgers (c’est comme ça qu’on appelle les flics, sponsorisés par la chaîne de fast-foods Whoomphy et son mythique « W »), même les mendiants publiexcités dans leurs trous officiels, tous ne jurent que par leurs jetons. JOUEZ POUR GAGNER ! Achetez vos osselets, matez la danse lascive de la belle Cookie Luck, et laissez la magie opérer : si vos dominos correspondent aux points qu’affiche la combinaison de miss fortune quand elle s’immobilise, alors vous devenez M. Million ! Mais gare au Bouffon-Double…  Avec ses cinquante fragments, dubs et (tout de même) nouvelles, souvent liés entre eux (par un personnage, un thème ou un sample…), le kaléidoscopique Pixel Juice, grand mix d’imaginaire, nous fait lui aussi passer à travers le(s) miroir(s) labyrinthiques de notre société de l’information et du virtuel, où tout se confond, où tout peut arriver, et arriver de mille façons – surtout dans nos crânes et dans les réseaux informatiques. Et dans les livres de Noon. Dans le prologue et l’épilogue du recueil, l’auteur évoque un événement marquant (authentique ou pas) de son enfance, lorsqu’il avait sept ans : un camarade lui propose d’échanger sa superbe maquette d’Aston Martin contre une montre invisible. Le petit garçon accepte, bien sûr. Trop naïf aux yeux des autres, il semble pourtant avoir gagné au change : le pouvoir de l’imagination est illimité.
Avec ses cinquante fragments, dubs et (tout de même) nouvelles, souvent liés entre eux (par un personnage, un thème ou un sample…), le kaléidoscopique Pixel Juice, grand mix d’imaginaire, nous fait lui aussi passer à travers le(s) miroir(s) labyrinthiques de notre société de l’information et du virtuel, où tout se confond, où tout peut arriver, et arriver de mille façons – surtout dans nos crânes et dans les réseaux informatiques. Et dans les livres de Noon. Dans le prologue et l’épilogue du recueil, l’auteur évoque un événement marquant (authentique ou pas) de son enfance, lorsqu’il avait sept ans : un camarade lui propose d’échanger sa superbe maquette d’Aston Martin contre une montre invisible. Le petit garçon accepte, bien sûr. Trop naïf aux yeux des autres, il semble pourtant avoir gagné au change : le pouvoir de l’imagination est illimité.
 Né le 15 novembre 1930 dans une vaste zone internationale de Shanghai (son père travaille dans le textile), Ballard fréquente l’English Cathedral School jusqu’au déclenchement de la Seconde guerre sino-japonaise (1937) : sa famille est alors contrainte de déménager dans un quartier à l’abri des affrontements. Après l’attaque de Pearl Harbour en 1941, les Japonais occupent la zone internationale et, en 1943, commencent à interner les civils des pays Alliés : James passe deux ans de son adolescence au camp de Longhua – au Bloc G, avec ses quarante chambres qui chacune abritaient une famille –, en compagnie de deux mille prisonniers, avec ses parents et sa jeune sœur, assistant aux cours donnés par les professeurs du camp. Ballard s’inspirera largement de cette expérience marquante (illusion de normalité masquant une situation critique) pour son roman
Né le 15 novembre 1930 dans une vaste zone internationale de Shanghai (son père travaille dans le textile), Ballard fréquente l’English Cathedral School jusqu’au déclenchement de la Seconde guerre sino-japonaise (1937) : sa famille est alors contrainte de déménager dans un quartier à l’abri des affrontements. Après l’attaque de Pearl Harbour en 1941, les Japonais occupent la zone internationale et, en 1943, commencent à interner les civils des pays Alliés : James passe deux ans de son adolescence au camp de Longhua – au Bloc G, avec ses quarante chambres qui chacune abritaient une famille –, en compagnie de deux mille prisonniers, avec ses parents et sa jeune sœur, assistant aux cours donnés par les professeurs du camp. Ballard s’inspirera largement de cette expérience marquante (illusion de normalité masquant une situation critique) pour son roman 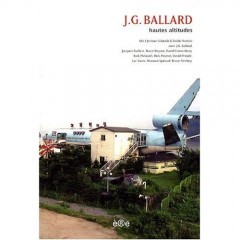 […] dans « Suburbia », lumineux article initialement publié dans le catalogue de l’exposition Airs de Parisdu Centre Georges Pompidou, le philosophe Bruce Bégout, fin observateur de le périurbanisation du monde (lire l’excellent
[…] dans « Suburbia », lumineux article initialement publié dans le catalogue de l’exposition Airs de Parisdu Centre Georges Pompidou, le philosophe Bruce Bégout, fin observateur de le périurbanisation du monde (lire l’excellent 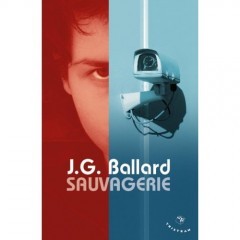 Pangbourne Village est un enclos résidentiel du Berkshire, non loin de Londres. Dix familles aisées – banquier, assureur, courtier en bourse, psychiatre, PDG, anciennes gloires du sport, pianiste de concert et autres riches propriétaires – vivaient dans cette édénique enceinte de seize hectares, surprotégée, clôturée, munie d’alarmes électriques, parcourue par des patrouilles régulières et aux avenues et allées privées surveillées vingt-quatre heures sur vingt-quatre par des caméras vidéo. On y nageait dans un tel bonheur qu’une équipe de la BBC s’apprêtait à y tourner un édifiant documentaire. Alors, comment expliquer l’assassinat de trente-deux personnes (tous les résidents adultes, les gardiens et des membres du personnel domestique), et la soudaine disparition de douze enfants et adolescents ?... C’est ce que cherche à comprendre Richard Greville, consultant psychiatre adjoint mandé par le Home Office, auteur du journal médico-légal que nous lisons. Toutes les hypothèses sont examinées, des moins inconcevables (tueur fou, groupe de déséquilibrés…) aux plus improbables (expédition punitive d’un cartel de drogue, erreur de parachutage d’une unité de commandos soviétiques, chute accidentelle d’un gaz neurotoxique expérimental qui aurait provoqué un dérèglement mental chez les habitants d’une agglomération voisine, manipulation inconsciente par des puissances étrangères, élimination par des extraterrestres en quête de jeunes spécimens humains, parents assassinés par leurs propres enfants…) mais aucune n’est jugée réaliste par les autorités. Deux mois après les événements, la police ignore encore tout de l’identité des coupables, et n’a trouvé aucune trace des enfants kidnappés. Le docteur Greville, chargé du dossier, est d’abord incrédule lui aussi, mais à mesure qu’en compagnie du sergent Payne il s’imprègne de l’atmosphère doucement concentrationnaire de la résidence, il finit par reconstituer les faits, et par entrevoir une vérité extrêmement dérangeante…
Pangbourne Village est un enclos résidentiel du Berkshire, non loin de Londres. Dix familles aisées – banquier, assureur, courtier en bourse, psychiatre, PDG, anciennes gloires du sport, pianiste de concert et autres riches propriétaires – vivaient dans cette édénique enceinte de seize hectares, surprotégée, clôturée, munie d’alarmes électriques, parcourue par des patrouilles régulières et aux avenues et allées privées surveillées vingt-quatre heures sur vingt-quatre par des caméras vidéo. On y nageait dans un tel bonheur qu’une équipe de la BBC s’apprêtait à y tourner un édifiant documentaire. Alors, comment expliquer l’assassinat de trente-deux personnes (tous les résidents adultes, les gardiens et des membres du personnel domestique), et la soudaine disparition de douze enfants et adolescents ?... C’est ce que cherche à comprendre Richard Greville, consultant psychiatre adjoint mandé par le Home Office, auteur du journal médico-légal que nous lisons. Toutes les hypothèses sont examinées, des moins inconcevables (tueur fou, groupe de déséquilibrés…) aux plus improbables (expédition punitive d’un cartel de drogue, erreur de parachutage d’une unité de commandos soviétiques, chute accidentelle d’un gaz neurotoxique expérimental qui aurait provoqué un dérèglement mental chez les habitants d’une agglomération voisine, manipulation inconsciente par des puissances étrangères, élimination par des extraterrestres en quête de jeunes spécimens humains, parents assassinés par leurs propres enfants…) mais aucune n’est jugée réaliste par les autorités. Deux mois après les événements, la police ignore encore tout de l’identité des coupables, et n’a trouvé aucune trace des enfants kidnappés. Le docteur Greville, chargé du dossier, est d’abord incrédule lui aussi, mais à mesure qu’en compagnie du sergent Payne il s’imprègne de l’atmosphère doucement concentrationnaire de la résidence, il finit par reconstituer les faits, et par entrevoir une vérité extrêmement dérangeante…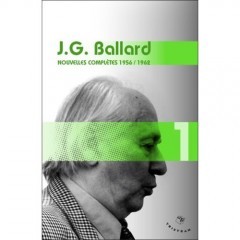 La plupart de ces nouvelles, sans doute marquées par l’internement de Ballard dans un camp de prisonnier japonais en Chine, nous parlent d’une manière ou d’une autre d’enfermement, d’aliénation, d’entropie, de surveillance et de contrôle, mais, comme dans les romans qu’il écrira par la suite, jamais l’auteur de
La plupart de ces nouvelles, sans doute marquées par l’internement de Ballard dans un camp de prisonnier japonais en Chine, nous parlent d’une manière ou d’une autre d’enfermement, d’aliénation, d’entropie, de surveillance et de contrôle, mais, comme dans les romans qu’il écrira par la suite, jamais l’auteur de 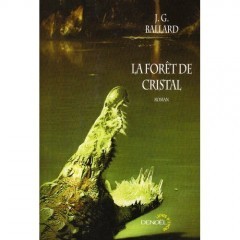 Si le roman, lumineuse inversion de
Si le roman, lumineuse inversion de 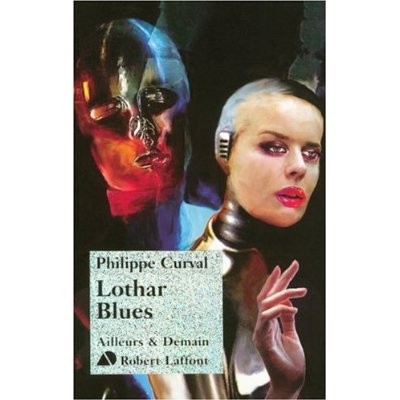

 Enfin, signalons un article de Denis Labbé consacré à
Enfin, signalons un article de Denis Labbé consacré à